Vous êtes ici :
Accueil
> Contes, nouvelles, chansons, presse, radio, films, pages d’histoire
> Union des Patoisants en Langue Romane, Belfort-Montbéliard
> François Busser : Connaissance du Patois du Nord Franche-Comté

Par :
Fleury LJ
Publié :
30 mai 2013
Un ouvrage vient de paraître
François Busser : Connaissance du Patois du Nord Franche-Comté
Un bel ouvrage vient de paraître. François Busser a mis ses nombreuses compétences au service de l’illustration et de la connaissance de notre « langue du coeur ».
Nous le remercions et nous nous réjouissons de découvrir son oeuvre.
Vous trouverez ci-dessous la page de titre, l’avant-propos et la table des matières.
{ {{On peut se procurer cet ouvrage au siège de l’association : Union des Patoisants 4 rue d’Argiésans 90800 BANVILLARS, France
Tel : 03 84 21 58 23
au prix de 20€ (23FS).}} }
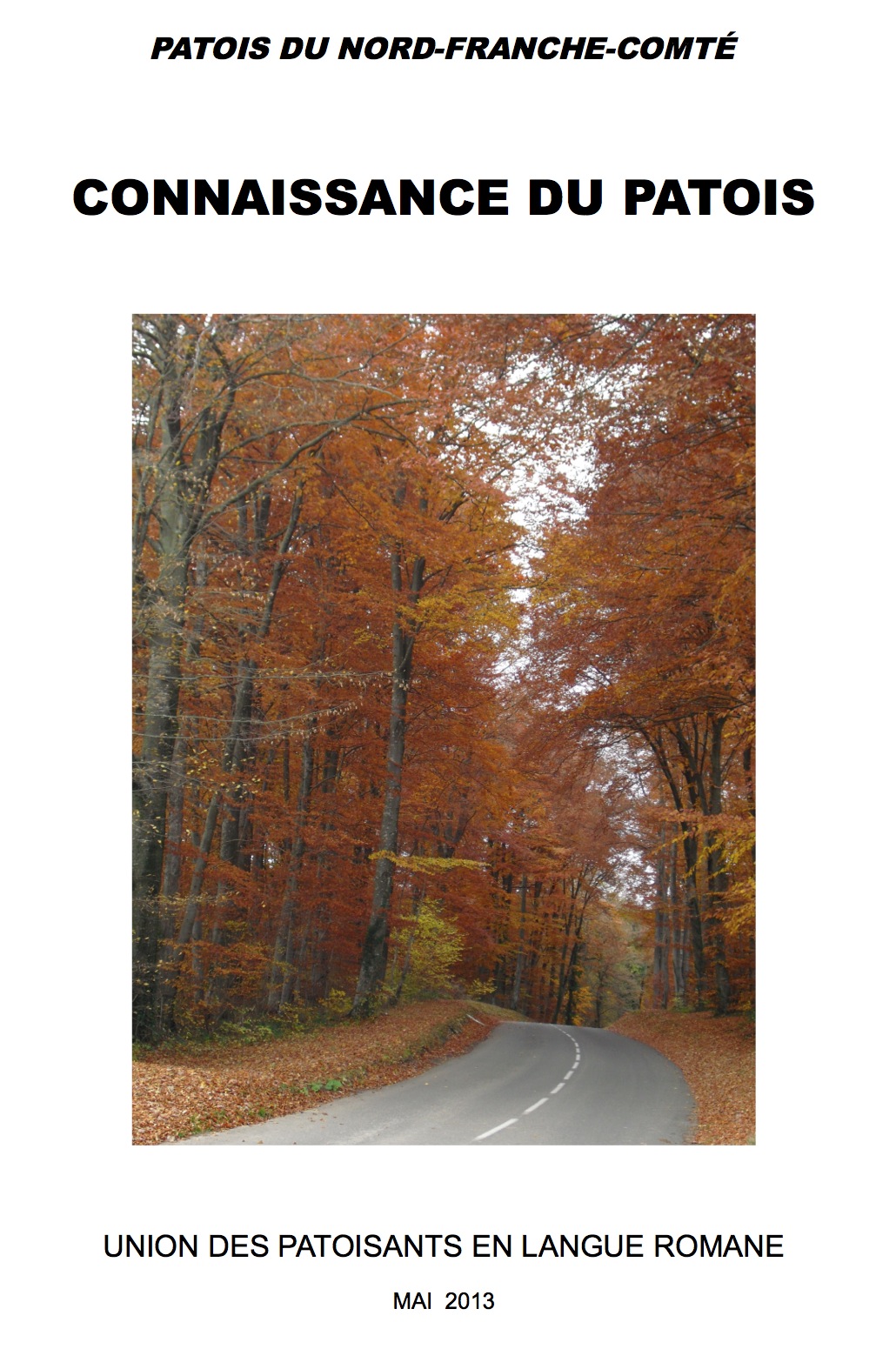
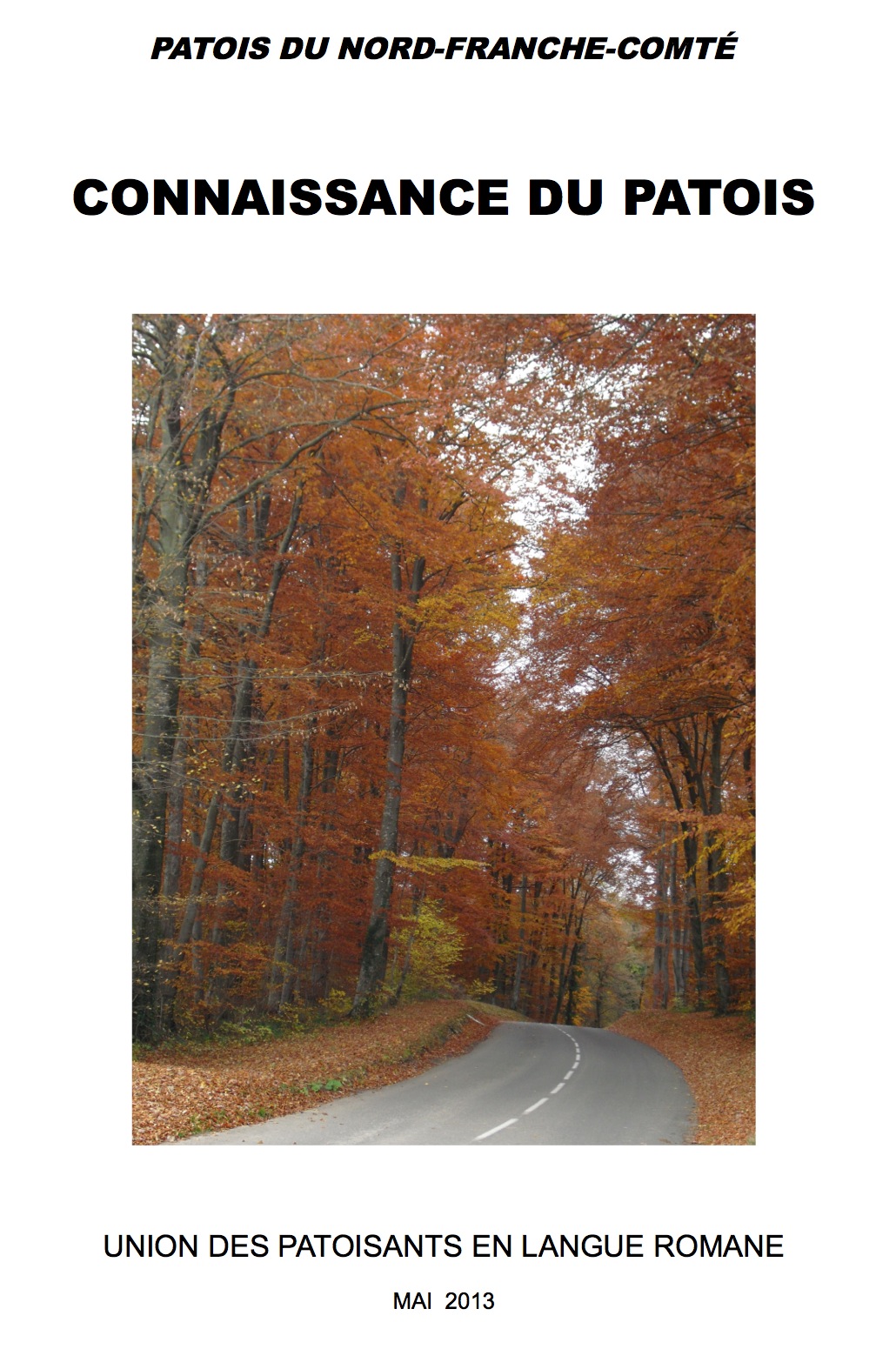
CONNAISSANCE DU PATOIS DU NORD-FRANCHE-COMTE
{{AVANT PROPOS}} L’association que j’ai l’honneur de présider actuellement s’intitule « Union des Patoisants en Langue Romane ». Cette dénomination peut paraître paradoxale puisqu’elle contient deux termes qui semblent incompatibles. En effet, sa raison d’être, ce qu’elle s’est donné pour objectif de conserver et de diffuser, est-ce un « patois » ou une « langue » ? La réponse vous la trouverez tout au long des pages qui suivent : notre patois du Nord Franche-Comté est une langue romane à part entière. Toutes les langues ont d’abord été parlées spontanément et par nécessité. Exclusivement orales, elles ne se souciaient pas de leur statut et ne cherchaient pas à se comparer entre elles. Pendant plus de quinze siècles les habitants de notre région ont communiqué entre eux sans se préoccuper du Français d’Ile de France ou du Latin des clercs et des savants. Des évolutions politiques et socio-économiques ont peu à peu imposé le langage du pouvoir central et de la capitale comme langue véhiculaire. A partir du XVI° siècle une abondante littérature lui a donné ses lettres de noblesse vis-à-vis de la langue de Cicéron et de Saint Augustin. Au XIX° l’école lui attribuera une situation de monopole : le patois se trouvera dès lors marginalisé. Il sera considéré, de facto, comme fruste, rustique, maladroit, symbole de l’inculture et de la stagnation intellectuelle. Pourtant, qu’en serait-il si le patois avait pris place dans nos salles de classe ? On l’aurait enseigné, on aurait appris à le parler, à l’écrire de façon systématique, il serait devenu objet d’étude. On aurait découvert son originalité, ses nuances, son fonctionnement et personne ne le traiterait avec condescendance. Longtemps langue du peuple, langue des illettrés, le patois – avec retard certes – est devenu aussi une langue écrite. Dès le milieu du XIX° siècle, des esprits éclairés ont senti cette nécessité de la transmission par la graphie et la publication. Ils avaient vu juste, car, depuis, la production littéraire en patois n’a fait que croître et s’épanouir. Des textes touchant à tous les genres littéraires ont mis en valeur la saveur, la précision et la sensibilité du patois. Parallèlement de remarquables glossaires ont révélé sa richesse lexicale ; ils en ont aussi précisé l’orthographe, laquelle fut longtemps hésitante. Le moment semble donc venu de proposer un manuel à ceux qui veulent connaître ou mieux connaître le patois de notre région. Ils trouveront les grandes caractéristiques de cette langue, ses règles, sa morphologie et sa syntaxe, accompagnées de nombreux exemples. Ce regard n’a pas de prétention savante, il n’a rien d’exhaustif, c’est simplement la mise en ordre de ce que l’on peut constater, en observant le patois de façon analytique. Cette description de la langue est suivie d’un recueil de morceaux choisis, qui, en suivant un ordre chronologique, offrent un panorama de la production littéraire en patois. La présence systématique de traductions en facilitera l’accès. Il n’est pas toujours facile de retrouver des publications depuis longtemps épuisées. Par ailleurs, durant ces dernières décennies, la production écrite a été particulièrement abondante. Il a donc fallu opérer des choix, qui sont évidemment discutables. Cela devrait susciter l’élaboration d’autres recueils plus complets, mieux documentés. Je suis conscient de toutes les insuffisances du présent ouvrage. Celui-ci n’a d’autre ambition que de faire apparaître le patois du Nord Franche-Comté comme une langue régionale, au même titre que bien d’autres en France et ailleurs. Ni plus, ni moins. F. Busser, président de l’Union des Patoisants en langue Romane Un grand merci à Jean-Marc Juillerat pour ses suggestions judicieuses et ses très importants travaux de recherche documentaire. Sans lui rien n’aurait été possible. ----SOMMAIRE.
DESCRIPTION DE LA LANGUE I. PRESENTATION GENERALE Les origines du patois Géographie du patois Le lexique du patois II. NOTIONS PRELIMINAIRES La prononciation L’orthographe Nombres et genres L’article III. MORPHOLOGIE 1) Les noms 2) L’adjectif L’adjectif qualificatif Les adjectifs numéraux 3) Le pronom Les pronoms/adjectifs démonstratifs Les pronoms personnels Les pronoms/adjectifs possessifs Les pronoms relatifs Les pronoms/adjectifs interrogatifs Les pronoms/adjectifs indéfinis 4) Les verbes Modes et temps Tableaux des conjugaisons Remarques sur la conjugaison 5) Les adverbes Adverbes de manière Adverbes de lieu Adverbes de temps Adverbes de quantité Adverbes de négation Adverbes d’affirmation 6) Les conjonctions de coordination 7) Les prépositions 8) Les exclamations IV. SYNTAXE DE LA PHRASE 1) L’affirmation, l’expression de la pensée 2) L’ordre, la défense 3) L’interrogation 4) L’hypothèse 5) Le souhait 6) Le but 7) La conséquence 8) La cause 9) Les circonstances de temps 10) La comparaison 11) La concession V. ANNEXES Quelques expressions récurrentes Expressions originales et particulières ANTHOLOGIE Le Chant du Rosemont Porte Noire et Pilory Noëls bisontins Les Painies Poème en l’honneur de la Vierge Marie Deux chansons Charles Contejean La Crèche comtoise Auguste Vautherin La Lettre de Bonfol Charles Roussey L’Ermite de la Côte de Mai Publications de la « Belle Epoque » Jules Surdez Maîtres d’école Lucien Lièvre Comberut Georges Becker Djosèt Barotchèt Jeanne Giraud Maurice Bidaux Jean Christe Henri Bron Valérie Bron René Pierre Pierre Mathiot Madeline et Etienne Marie-Louise Oberli – Wermeille Gaston Brahier Jean-Marie Moine Enseignants Ajoulots Eribert Affolter Voiyïn DESCRIPTION DE LA LANGUE- Podcast et RSS
- Plan
- Contact
- Mentions
- Aide
- Rédaction
- Se connecter

-
2004-2024 © Djasans - Tous droits réservés
Ce site est géré sous SPIP 3.2.19 [24404] et utilise le squelette EVA-Web 4.2

Dernière mise à jour : vendredi 26 juillet 2024
